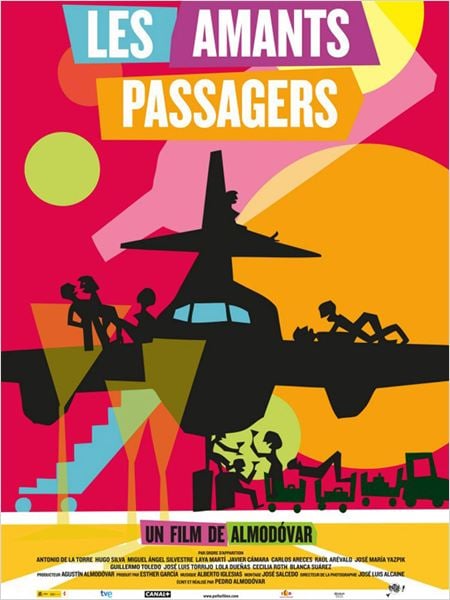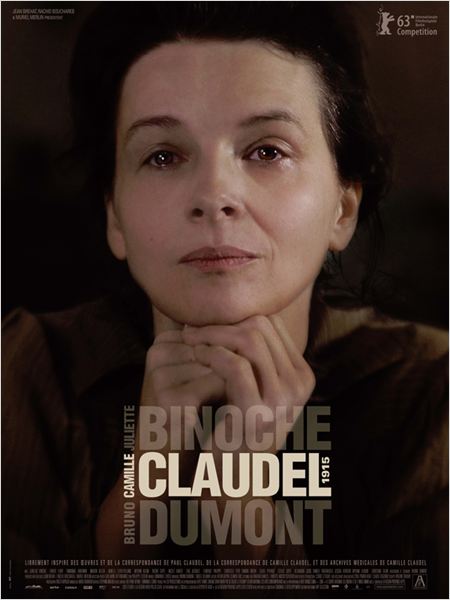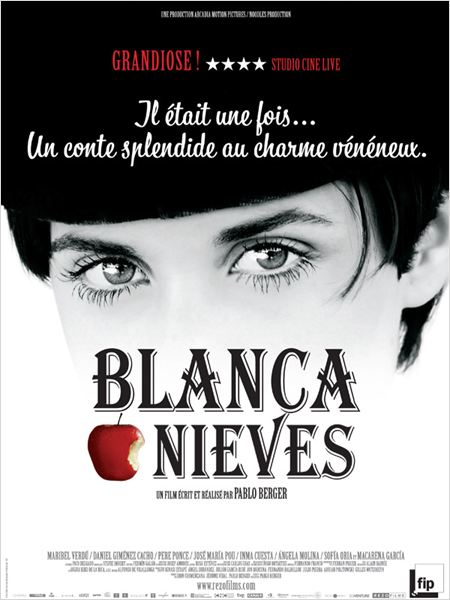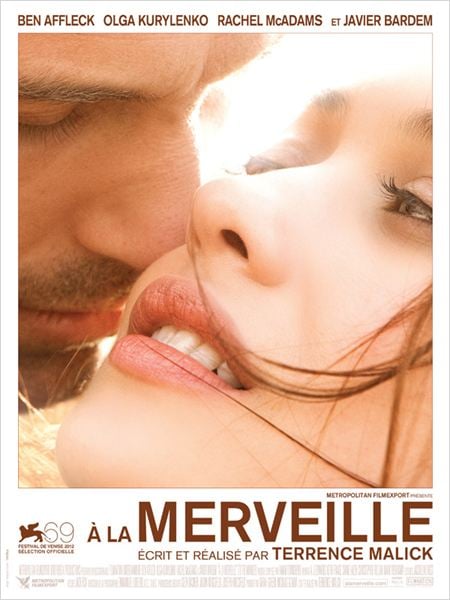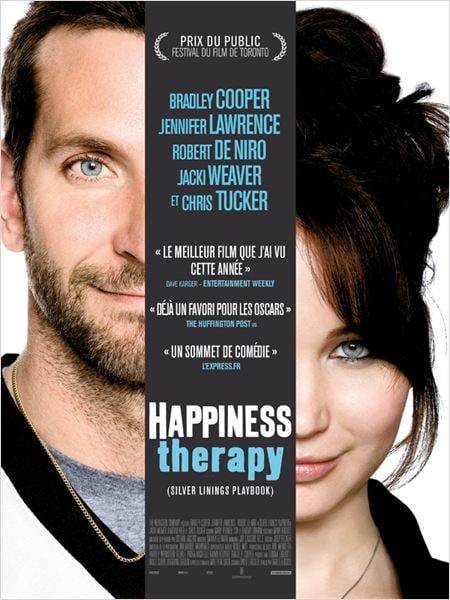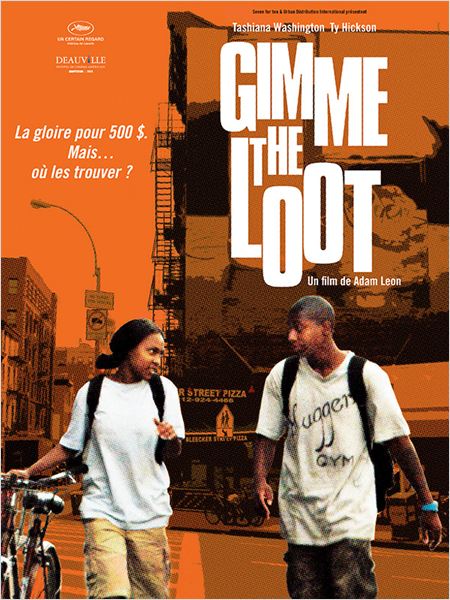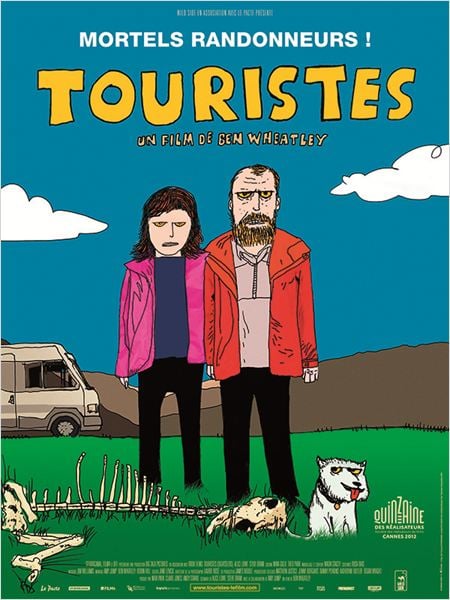Oui, donc, pour vous prouver que je n'écoute pas que de la musique de chanteuse à pédés, voilà la suite. Le mois de mars a été un très bon cru. Mais jugez plutôt.
FAUVE ≠
Alors, d'abord, clarifions : il y a deux artistes qui s'appellent Fauve. Un chanteur Suisse, et un groupe français. Ou plutôt un collectif : pas de leader, des membres qui gravitent, tout ça. C'est de ce deuxième cas que je vous parle. Ils sortent leur premier EP bientôt, mais en attendant, ils font déjà parler d'eux grâce à la diffusion de quatre chansons, en téléchargement libre sur leur page Facebook. La voix est rauque et sensible, nerveuse et peinée, elle s'inscrit dans une urgence qui caractérise le collectif. Car ce qui marque le plus sont les textes : ils dépeignent avec violence et réalisme les dérives de la société. Et leur prouesse est de le parvenir à le faire sans démagogie et sans militantisme creux. Ils exposent simplement les doutes d'une génération paumée, dans lesquels les auditeurs semblent se retrouver, car leurs mots expriment ces sentiments d'abandon, de dépassement, de vertige que le monde actuel nous apportent. Le tout avec, comme ils le disent avec lucidité, "un optimisme désespéré". La musique, quant à elle, est riche, profonde et variée, elle déconstruit les genres et varie les instrumentations tout en restant mélodieuse et entraînante, sous les scansions du chanteur. Aussi la curiosité quant à leur premier opus est-elle grande. En attendant, leurs quatre morceaux, que vous pouvez retrouver ici, sont une réussite.
Alt-J - An Awesome Wave
Évidemment, puisque tout le monde en parle. Et pour cause, en fait. Le groupe qui fait chavirer les cœurs des hipsters et des autres (je ne sais pas encore bien dans quelle catégorie je me situe, j'y réfléchis), par leur façon décalée de faire de la musique. Leur musique recèle une originalité formelle peu commune, que ce soit au niveau de l'album, divisé en interludes, des morceaux, à la structure souvent surprenante, ou de la musique, aussi légère que travaillée. Leurs inspirations sont diverses, du cinéma à l'actualité, mais ils parviennent à toujours y mettre une empreinte indéfinissable qui leur est propre. Ainsi entrera-t-on avec aisance et plaisir dans leur monde psychédélique en noir et blanc, avec l'hypnotique "Tessellate", l'enthousiasmante "Breezeblocks", la douce "Matilda", l'authentique "(Interlude 1)", et on lâche totalement prise sur la très riche "Intro" ou l'entraînante "Fitzpleasure". Le timbre de voix particulier berce et avive à la fois, et ce groupe ultra-trendy signe ici un premier album captivant.
Two Door Cinema Club - Beacon
L'autre groupe à la mode du moment, "Two Door Cinema Club" propose une musique d'une pure pop-rock limpide et claire. C'est en fait exactement ça : le groupe remplit parfaitement le contrat de ce genre, il lui offre un opus qui le définit presque. Les guitares rencontrent la batterie, et avec la voix masculine, entre l'aigu et le grave, naissent des chansons dansantes de qualité, telles que "Sleep Alone", "Sun" ou "Wake Up". Le groupe exprime ponctuellement des mélodies plus recherchées, avec notamment le morceau "The World Is Watching", ou "Settle", qui accomplissent l'exploit supplémentaire d'une touche personnelle qui tient un peu à distance le formatage du genre. Dans tous les cas, le groupe a compris quelque chose, et fournit un album d'un niveau de qualité supérieur, et maintenu à travers toutes les pistes. On peut enfin profiter d'une pop-rock qui se maîtrise et se transcende, et si elle reste presque sagement à l'intérieur de ces limites ("Beacon" signifie "borne" en anglais), elle en exploite le potentiel au maximum. Il n'y a qu'à se réjouir.
Lykke Li - Youth Novels
J'ai parlé la dernière fois de son second album, "Wounded Rhymes". Je me suis penché ce mois-ci sur sa première œuvre, qui elle aussi porte parfaitement son nom. C'est toujours amusant de faire le chemin dans ce sens inverse, quand on découvre un artiste : remonter son évolution jusqu'à ses prémices. On peut conclure que Lykke Li avait déjà du talent, et pour ce premier album, comme beaucoup de musiciens, elle expérimente énormément, et son disque apparaît comme un patchwork de chansons-vignettes qui chacune explore presque un genre musical différent, quasiment toujours avec brio. On appréciera donc l'électro, scandée dans "Complaint Department" ou "I'm Good, I'm Gone", l'inclusion de jazz dans "This Trumpet In My Head", l'intimiste "Melodies & Desires", la pop réjouissante de "Dance Dance Dance" et "Little Bit". Le tout est cependant régi par un entrain et un dynamisme, parfois boudeur, parfois joyeux, mais qui en veut toujours. La chanteuse suédoise s'est donc beaucoup amusée, et nous avec, avant de se recentrer sous l'égide de ses "Wounded Rhymes". Maintenant, il faudra reprendre le cours normal de son chemin avec le prochain album...
Et pour finir dans la joie et la bonne humeur ... ICONA POP ! I DON'T CAAAAARE ! I LOVE IT !!!!!!!!!!