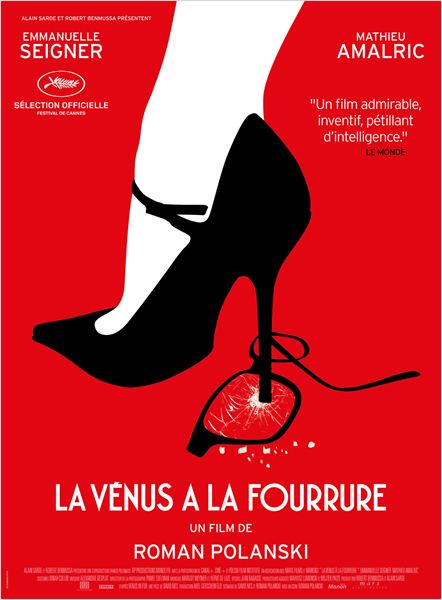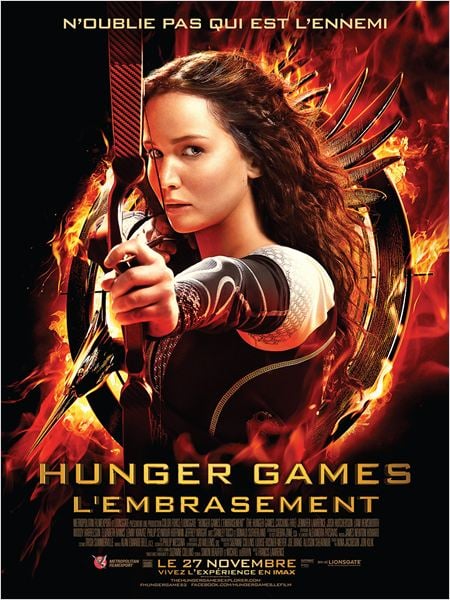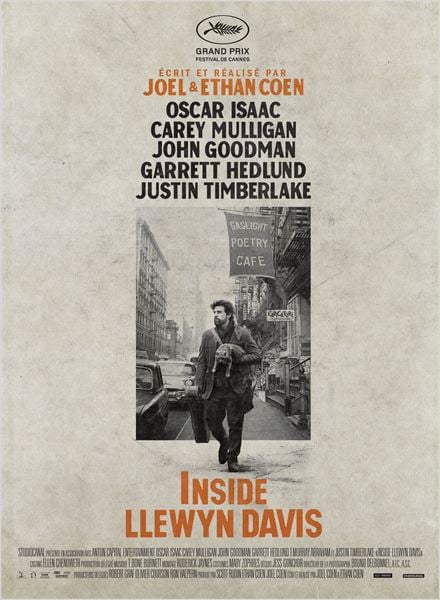BON. Avant de commencer, je vais le sortir de mon système : "JE... SAIS, TU N'EXISTEUH PAS, SUZANNE... POURTANT JE TE PARLE, POURTANT JE TE PAAAAAARLE..." Voilà, maintenant que ça, c'est fait, on peut y aller.
Katell Quillévéré met en scène dans son second long-métrage ce que l'on entend souvent s'appeler un "drame social". Mais c'est sur un quart de siècle qu'elle le fait : on découvre Suzanne et sa grande sœur Maria, enfants, jouer et pleurer avec leur père veuf, incarné avec force par François Damiens, avant de retrouver presque immédiatement tout ce monde dix ans plus tard. Tout le film fonctionnera de cette manière : d'ellipse en silence, les chocs et les drames seront éludés, pour ne s'intéresser qu'à l'après, aux cœurs brisés qui continuent face aux drames inexorables contre lesquels ils ne peuvent plus rien. La narration garde néanmoins une clarté impeccable dans son portrait d'une femme qui se perd et suit sa voie à la fois.
Suzanne, c'est Sara Forestier, la fervente, l'indomptable, la lumineuse Sara Forestier. Tout en gardant les qualités de joyeuse sauvageonne qui font d'elle la comédienne qu'elle est, elle s'assouplit, s'adoucit même, pour devenir parfaitement cette jeune femme, d'abord fille-mère, puis fugitive, criminelle, détenue... Mais ce n'est pas elle que Quillévéré suit pendant ses fugues : ce sont les yeux cernés de la prometteuse Adèle Haenel, sœur épuisée. Les retrouvailles ensuite se font sans heurts, avec l'évidence de l'indicible : loin des hurlements culpabilisateurs ou des violons des circonstances atténuantes, les moments d'émotion s'en feront d'autant plus bruts et étouffants.
En dépit de cela, les erreurs seront recommencées, les drames accumulés, les essais ratés, souvent. Au milieu de toutes ces petites tragédies, on retrouve Corinne Masiero dans le rôle le plus inattendu qu'on ait pu lui donner dans le film et qu'elle interprète avec le talent qu'on lui connaît. Elle symbolise tout ce que le film prétend : la force de continuer, d'essayer encore malgré le malheur que l'on ne peut pas annuler, dans une optique résolument tournée vers l'avenir. Les couleurs d'ailleurs sont vives, l'image ensoleillée, comme ce sourire final de Suzanne, "très heureuse", quand même, malgré tout : les gens qui s'aiment se voient, se comprennent, restent.
dimanche 29 décembre 2013
samedi 28 décembre 2013
"La Vénus à la Fourrure", Roman Polanski
Je n'avais pas du tout apprécié "Carnage", le précédent film de Polanski (dont j'ai publié la critique il y a deux ans jour pour jour, ça nous rajeunit pas, hein) une adaptation d'une pièce de théâtre dont on cherchait en vain l'intérêt. Je n'étais donc pas très motivé pour voir ce nouvel opus, d'autant plus qu'il s'agit cette fois encore d'un huis-clos et que cela parle d'une pièce de théâtre. Mais les bonnes critiques m'ont convaincu et je ne suis pas déçu.
Mathieu Amalric est une sorte d'alter-ego de Polanski : metteur en scène, il cherche désespérément une actrice pour incarner Vanda, femme dominatrice dans le roman sadomasochiste qu'il adapte en pièce de théâtre. Arrive alors Emmanuelle Seigner (et c'est reparti pour mille mots-clés Google la recherchant nue, elle ou sa sœur...) : une comédienne vulgaire et écervelée qui le convainc néanmoins de la laisser auditionner. Seigner surjoue dès lors qu'elle joue ce rôle, mais, à l'image de son personnage, se métamorphose dès qu'elle interprète le personnage de la pièce ; on en vient même à se demander si tout était prévu... Comme cette délicieuse introduction burlesque dans une avenue parisienne grise et pluvieuse.
Il faut dire que l'histoire toute entière de ce huis-clos est particulièrement bien ficelée. L'écriture est particulièrement fine et la conclusion aussi inattendue que parfaitement pensée. Les niveaux de lecture se superposent, puis se croisent, pour finir par se mélanger, se confondre et même se rassembler. La Vanda comédienne est-elle une Vanda-personnage, ou bien une autre version d'Emmanuelle Seigner, ou encore cette apparition de Vénus que les acteurs s'amusent à invoquer ? Et ce Thomas, est-il artiste incompris, soumis refoulé ou machiste incorrigible ? Peut-être tout cela, alors que les rapports de force théâtraux se rapportent à la hiérarchie entre actrice et metteur en scène, et aussi aux relations homme-femme, entre amour et dégoût, souffrance et plaisir.
Cette fois, Polanski parvient à merveille à trouver les limites entre le théâtre et le cinéma, jusqu'à jouer avec elles, exploiter pleinement le potentiel de la rencontre de ces deux arts. Le film ne ressemble jamais à du théâtre filmé et, à vrai dire, n'est jamais imaginable en pièce : l'abord cinématographique est indivisible, mais à travers ce prisme, le théâtre est présenté dans un écrin qui le sublime. La mise en scène théâtrale et la mise en scène filmique opèrent en synergie pour venir davantage brouiller les pistes au milieu du sujet complexe entrepris par le réalisateur avec une intelligence honnête et désarmante.
samedi 21 décembre 2013
"Les Garçons et Guillaume, à table !", Guillaume Gallienne
T'as vu t'as vu le succès du box-office qui parle de djendeur ? Mais si, mais si, c'est le spectacle de théâtre, là, à propos de la fiotte qui n'en était pas une, ça a bien marché alors le gars en a fait un film et ça cartonne.
Guillaume Gallienne est sur tous les fronts dans ce qui apparaît clairement comme le projet de sa vie. Bien entendu, il joue le rôle de sa mère, avec un talent indéniable et assez incroyable, et, pour son propre rôle, déploie de rares capacités de comédien. De plus, pour cette adaptation au cinéma dont il aurait apparemment toujours rêvé, il choisit le parti-pris intéressant d'en conserver l'origine théâtrale. La mise en scène porte bien son nom : elle passe ici par des séquences qui rythment le film et où Guillaume Gallienne, narrateur, acteur, raconte son histoire sur les planches. Cela permet quelques procédés vivifiants, parmi lesquels les apparitions fantasmées de la mère, ainsi qu'un double-jeu qui porte plus loin la mise en abyme sur l'autofiction.
Mais dans la transition, la structure du film est un peu déséquilibrée. Tout d'abord, certaines blagues fonctionnent beaucoup moins bien, et beaucoup d'anecdotes qui devaient très bien passer en tant qu'apartés deviennent ici sketchs superflus, notamment les scènes de l'inattendue Diane Kruger. De manière générale, l'histoire glisse, parfois, un peu : les questionnements du personnage constituent le sujet principal, bien sûr, mais cela manque rapidement d'enjeu autre que l'auto-contemplation bourgeoise. Cela ne l'empêche pas de toucher très juste, par moments : aussi bien dramatiquement, sur les sujets de l'exclusion, de la discrimination, de la solitude et de la différence, que comiquement, avec en tête la délicieuse arrivée en Angleterre ("It's good for the health!").
On grincera davantage des dents face aux fréquents clichés sur les femmes, les arabes, etc. La résolution majore ce scepticisme dans ce qu'elle soulève. Certes, cette histoire est toujours présentée comme celle, unique, de son auteur, sans jamais prétendre à un caractère universel. C'est sans doute pourquoi elle ne se mouille jamais vraiment sur le sujet de la transexualité ; néanmoins sa fin façon solution psychanalytique de bas-étage (la mère castratrice !) à un problème qui n'était pas censé en être un a des relents d'une droite conservatrice et normative qui s'accorde d'ailleurs très bien avec l'univers des personnages... On préfèrera donc ne pas analyser trop en profondeur cette gentille comédie, au risque d'y trouver, sous couvert de l'honnêteté de parler du sujet, beaucoup de malaise et de méconnaissance quant au genre ; on se contentera de faire comme tout le monde et de sourire sans réfléchir, pire, sans être amené à réfléchir.
mercredi 18 décembre 2013
"The Hobbit : The Desolation of Smaug", Peter Jackson
Je n'ai pas vu le premier volet de cette trilogie, mais j'ai lu le livre dont elle est tirée. J'en garde un souvenir assez tendre et parfois un peu flippant. Le film fait un tout autre effet.
Bon, ce n'est pas une catastrophe, pas du tout. On est certes loin de l'épique hypertrophié du "Seigneur des Anneaux", mais on ne tombe pas non plus dans le navet sauce fantasy. On retrouve avec plaisir la transposition grand écran de l'univers de Tolkien et de sa richesse ici bien exposée lors des rencontres successives des Nains et du Hobbit avec les Orques, les Elfes, les Hommes, dans des décors bien sûr luxuriants quoique bien moins mis en avant que ce qu'on aurait aimé. La sensation de la menace qui se prépare dans ce prequel amène une dimension supplémentaire, bienvenue celle-ci, à l'histoire. Mais le film n'échappe pas aux énormes pièges du genre : en plus de la fatigante chance irréaliste des héros, plusieurs moments sont à se taper la tête contre le mur tant un tel degré de stéréotype kitsch devrait être interdit en salles. Le plus évident reste bien sûr cette histoire d'amour forcée entre une Elfe rebelle et le seul Nain (plus que) potable de la bande, dont chaque seconde est aussi fausse que superflue.
Si cette storyline est parfaitement inutile, hormis le quota "romance" que les scénaristes se sont sentis obligés d'ajouter pour une raison que l'on ne veut pas connaître, elle est loin d'être la seule. On s'en doutait en apprenant que ce qui devait initialement être un diptyque deviendrait, en un coup de bâton magique, une trilogie d'autant plus lucrative. Le film est extrêmement bavard et on ne comprend pas pourquoi il a besoin d'être si long si c'est pour raconter aussi peu de choses. Ses scènes s'étirent en longueur (un peu comme mes critiques) : chacune d'entre elles pourrait perdre une bonne minute, que ce soit des scènes de combat qui se répètent dans la surenchère tantôt comique, tantôt juste ennuyeuse, ou dans les dialogues patauds. Cette langueur est amplifiée par un scénario simpliste dont le caractère extrêmement feuilletonnant est certes efficace mais a poussé certains critiques à comparer la construction du film à un jeu d'arcade type "Donkey Kong" : problème-résolution-niveau suivant.
L'occasion de remarquer la qualité toute relative des effets
spéciaux, dont tout le budget semble être passé dans le très beau
dragon, au détriment de nombreuses inclusions sur fond vert complètement
dégueulasses et autres effets kitsch façon Windows Movie Maker (oui,
Sauron, c'est à toi que je parle). Concédons cependant que cela ne gâche pas un plaisir certain, porté surtout par un casting copieux : on retrouve Lee Pace méconnaissable et serpentin, Orlando Bloom vieilli
et nonchalant, Aidan Turner "plutôt grand pour un Nain", Richard
Armitage inspiré, Evangeline Lilly toujours oubliable... Mais surtout, surtout, Martin Freeman, choix en fait parfait pour le rôle, auquel il sait apporter, sans en délaisser le côté un peu sombre, une légèreté inattendue et salvatrice.
lundi 16 décembre 2013
"Casse-Tête Chinois", Cédric Klapisch
Ben oui, on a tous vu "L'Auberge Espagnole", puis "Les Poupées Russes". Schématiquement, le premier symbolisait la folie joyeuse de la vingtaine, le second le réveil soudain de la trentaine. La boucle est bouclée, sans doute, avec "Casse-Tête Chinois" qui vient achever la trilogie par la complexité évidente de la quarantaine.
On retrouve donc Xavier, le désormais irrésistible Duris à qui on pardonne ses quelques accès de surjeu, comme on recroiserait une connaissance du lycée : on n'était pas si proches et pourtant on est super contents de se demander des nouvelles. En ce qui le concerne, "c'est compliqué" : il vient de se séparer de Wendy (magnifique Kelly Reilly) qui part refaire sa vie à New York avec leurs deux enfants, qu'il décide de suivre... L'occasion d'emménager temporairement chez Isabelle, campée par Cécile de France que l'on redécouvre avec plaisir dans un rôle affiné auquel elle sait apporter la maturité nécessaire, et à qui il a accepté de donner son sperme pour une insémination artificielle (la PMA, elle est à nous...). Et pour compléter le tableau, beaucoup de péripéties loufoques, parmi lesquelles Audrey Tautou revient dans le rôle de cette Martine mal définie qui ne lui a jamais vraiment convenu, mais qu'elle semble attraper juste à temps.
Les retrouvailles ne s'arrêtent pas là : Klapisch lui-même reprend sa recette habituelle. New York lui offre l'écrin cinématographique éternel, dont il sait profiter par une réalisation claire et aussi foisonnante que son histoire. Celle-ci, encore une fois, part dans tous les sens et finit par se redresser en quelques considérations philosophiques simples mais efficaces. Dans l'entre-deux, s'enchaînent des gags pas toujours bien sentis, d'autres plus réussis, des erreurs, des quiproquos, des pauses, des absurdités et une myriade de clins d’œil. Le niveau - et c'est surprenant - est en fait similaire à celui des deux premiers volumes, dont il vient finaliser le propos avec une évidence insoupçonnée : c'est-à-dire que le film est un peu foutraque, pas toujours creusé mais globalement agréable.
On reconnaîtra à ce "Casse-tête chinois" une résolution assez inattendue quoi que facile avec le recul ; mais elle marquera surtout pour le changement de perspective qu'elle introduit soudain sur tout ce que le film disait jusque là. Cette acceptation pure et simple du casse-tête, cette décision que ce n'est pas si grave. Klapisch, qui semble extatique à l'idée de retrouver toute son équipe, ne peut s'empêcher d'ajouter une dernière séquence de flash-backs et de conclure par une réplique niaiseuse ; on préfèrera s'en tenir à la première fin, bien plus réussie dans cette dualité entre fiction et réalité qui intéresse. Au final, on retiendra ce qu'on voudra de la gentille trilogie de Klapisch : peut-être bien le portrait d'un grand gamin qui avait peur de grandir mais qui, tout à coup, se rend compte qu'il l'a fait sans s'en rendre compte, et dont les mini-révélations successives sont simples mais suffisantes. Et peut-être nécessaires ?
lundi 9 décembre 2013
"Hunger Games 2 : L'Embrasement", Francis Lawrence
Je suis allé voir la suite de ça, le premier film que j'avais moyen aimé. Bon, j'avoue qu'à l'époque, je ne savais pas que la trilogie était tirée d'une saga de livres et j'avais donc, à tort, interprété la fin comme une façon hollywoodienne d'assécher la vache à lait, alors qu'en fait, tout cela était prévu. Mea culpa. (Il n'empêche que c'était pas non plus ouf, ouf, hein.) Et en voyant que la critique (même les Inrocks, les gars ! même les Inrocks !) reconnaissait les vertus de cette suite, j'ai décidé de me faire un petit blockbuster dans une salle ENOOOOORME avec un écran ENOOOOORME parce que, une fois de temps en temps, ça fait du bien par où ça passe. (Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je vais enchaîner avec la critique.)
Il est évident que ce deuxième volet est largement plus réussi que le premier, parce qu'il sait axer sur les forces de la narration. Tout d'abord, il développe ce qui avait bien fonctionné dans le premier, l'histoire lui permettant d'explorer davantage ce monde dystopique dans lequel les personnages évoluent. Au début du film, Katniss et Peeta (c'est quand même moyen comme noms mais passons) font le tour des douze districts. (Aucune explication n'est donnée quant au fait que l'un d'entre eux ne regroupe que des blacks, sans doute le fameux quota ethnique rentabilisé en un lieu.) L'occasion d'approfondir une mythologie apparaissant assez riche. On aimerait d'ailleurs en voir encore plus, et c'est le seul moment où les deux heures et demie du film font preuve d'un rythme un peu trop soutenu, là où il est parfaitement maîtrisé par la suite en ne laissant place à aucune longueur, ni raccourci.
L'arrivée au faste du Capitole amène son nouveau lot de costumes extravagants et de décors colorés, entre quelques rares déceptions quant aux effets spéciaux... Mais cette fois, sur fond de lutte des classes. Et pour cause : les anciens des Hunger Games sont rappelés dans un nouveau combat anniversaire, mais il apparaît clair que plus personne ne veut de cette tradition. Les intéressés redoubleront de stratagèmes pour échapper à la décision; et le personnage d'Effie, notamment, viendra mettre en lumière cette contradiction inédite, en bénéficiant d'un développement aussi inattendu que bien senti. Il apparaît clair, en réalité, que Francis Lawrence veut mettre l'accent sur l'aspect adulte et noir de l'histoire : le film, soudain, se fait presque subversif, en portant haut et clair un message de rébellion contre l'injustice du système établi. C'est ce qui fait l'intérêt de ce second volume : il devient porteur d'un sens, certes en accord avec son statut premier de film adolescent, mais surtout intrinsèquement actuel, universel et vif.
Jennifer Lawrence doit, par son personnage, prendre cette responsabilité sur ses seules épaules. Elle s'en sort convenablement, soutenue par un scénario qui joue sur l’ambiguïté des intentions de Katniss, hésitante à accepter le rôle de symbole de la révolution. Pour parvenir à ce stade, les péripéties de la seconde partie du film s'enchaînent à une vitesse folle mais expliquée par la cruauté affichée des organisateurs. Elles n'échappent pas à une prévisibilité certaine, aux quelques facilités du genre et au recours à des personnages secondaires très stéréotypés, mais restent assez haletantes et prenantes : le coup de maître final (habituel?) est d'ailleurs indéniablement badass.
Les différentes révélations ne sont jamais complètement choquantes, car les ficelles se veulent sans doute plus visibles pour être compréhensibles. Mais on appréciera ce qu'elles préparent : un dernier épisode qui s'annonce sans doute encore plus axé sur cette portée révolutionnaire que l'on attendait pas de "Hunger Games". C'est bien la décision de redresser l'histoire là-dessus, au lieu de se cantonner à un épuisant triangle amoureux adolescent, réduit ici à un plan marketing et au strict mimimum de quelques scènes qui semblent très forcées (sans doute pour satisfaire les ados fans), qui redonne une couleur méritoire à la série, dont on attend désormais, et contre toute attente, la suite.
(Par ailleurs, je suis totalement team Gale, c'est une évidence.)
jeudi 5 décembre 2013
"Inside Llewyn Davis", Ethan & Joel Coen
mardi 3 décembre 2013
"La Marche", Nabil Ben Yadir
J'ai remarqué la chose suivante à propos des conversations sur les films ; souvent, la conclusion en est : "il faut aller le voir", ou son inverse. Parfois, cela prend même la forme de la naïve question correspondante : "Il faut aller le voir ?", comme si l'ensemble de l'histoire du cinéma se divisait en deux parties inégales, celle des films pour lesquels il n'est pas nécessaire de se déplacer, et celle de ceux où il le "faut". Une sorte d'obligation venue d'en-haut, indicible, insécable, injustifiable. Aussi, au sujet de "La Marche", inspirée de faits réels en 1983, pour une fois, je ne rédigerai pas de longue critique verbeuse et prétentieuse comme à ma tendre habitude. De toute manière, j'en serais incapable. A la place, je vous dirai juste : il faut aller le voir. Il le faut.
Inscription à :
Articles (Atom)