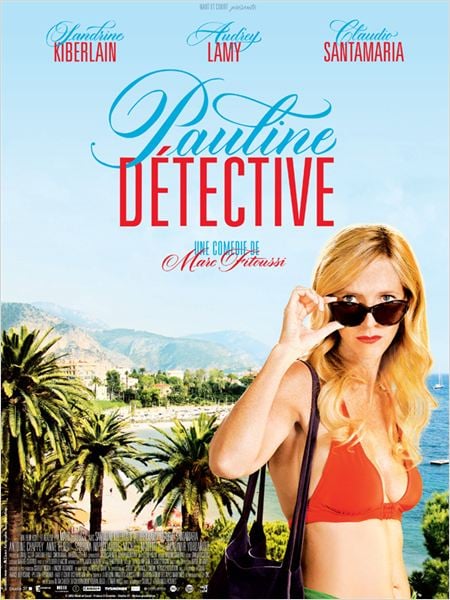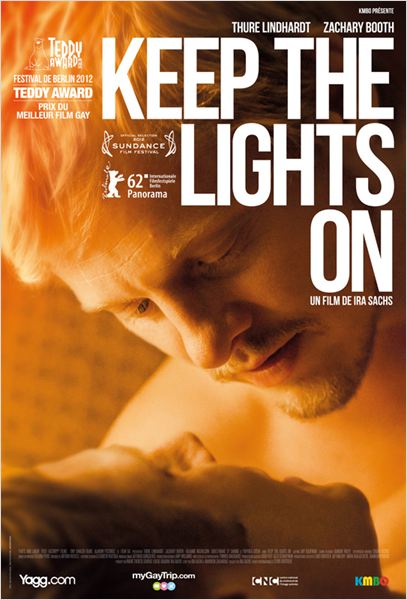L'histoire d'un homme humaniste, délaissé par ses proches, viré de son travail, diagnostiqué phase terminale, dans une Amérique qui le dégoûte, pleine de moquerie et de méchanceté acclamées, et qu'il n'arrive pas à raisonner, lui pauvre petit homme plein de bons principes, dans un océan de concitoyens hyper-consommateurs, impolis et mauvais. Alors, très justement, il décide de les tuer. Tous les perpétreurs de télé-réalité, d'anti-mariage gay, de bruit au cinéma. Et ce avec l'aide improbable d'une complice lycéenne, qui trouve ça définitivement trop cool.
Et ça l'est. Comment ne pas trouver jouissive cette irrévérencieuse réalisation de nos fantasmes les plus profonds, de notre fondamentale envie de tuer celui qui vit en désaccord avec ce que l'on considère juste ? C'est en fait un grand pied-de-nez à la sacrosainte liberté d'expression états-unienne : le film semble dire, ok, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de déconner. Et trouver là l'occasion de déconner encore plus. Les tueries les plus drôles et les plus éclatantes s'enchaînent avec joie, dans un humour noir délectable parfois souligné d'un gore épicé. Le tout sous une réalisation délicieusement indie, qui offre une image à la fois vive, claire et un brin rétro.
Mais à travers ce fun assumé, s'établit surtout toute une réflexion sur la société actuelle. Cette philosophie est certes un peu facile, et aussi souvent forcée en accentuant légèrement les travers des concitoyens de Frank (qui porte fort bien son nom), par exemple avec cette longue, agonisante séquence de zapping à la télévision au début du film, où toutes les émissions les plus cruelles et irrespectueuses, mais pourtant réalistes, s'enchaînent. Alors les mots de Frank, sertis dans des dialogues ciselés, tantôt hilarants, tantôt profonds, prennent certes parfois la tournure d'un discours de vieil aigri, mais résonnent surtout d'une vérité dérangeante et inattendue. Et à travers l'humour et le jenfoutisme, on se retrouve, sans prévenir, à s'interroger sur son propre comportement.
C'est en partie pour ça que ce film accomplit un exploit rare : plus on y repense, plus on l'apprécie. C'est sans doute aussi dû à la fraîcheur du duo des personnages, à leur psychologie touchante et subtilement bien explicitée, et à la relation complexe, peu conventionnelle et belle qui s'instaure entre les deux, à travers un jeu impeccable pour Joel Murray, torturé mais porteur d'un message simple, et Tara Lynne Barr, flippante et directe. Le tout est saupoudré d'amusantes références à la pop-culture américaine, qui viennent faire oublier le côté attendu que prend quelque temps le schéma narratif, avant de se redresser en une fin magistrale et tarantinienne, qui sait sublimer un long-métrage subversif, aussi drôle que tragique, aussi léger que profond.