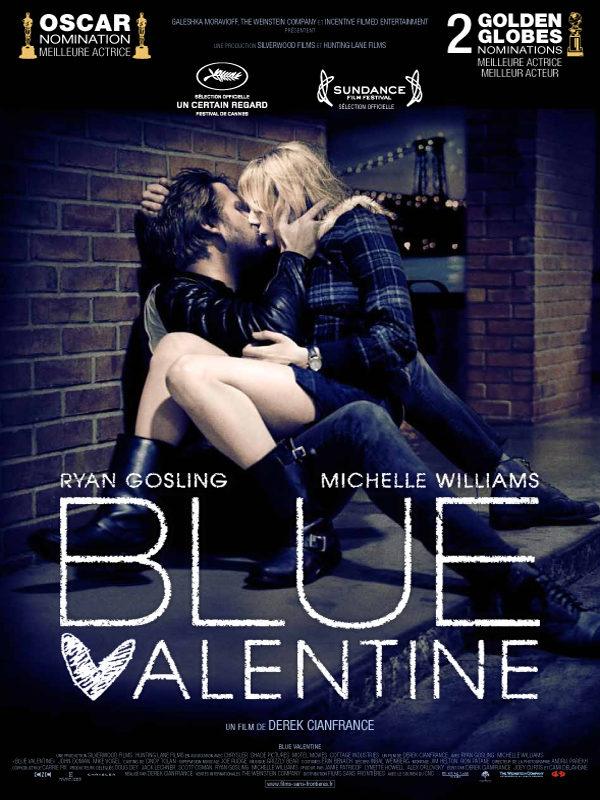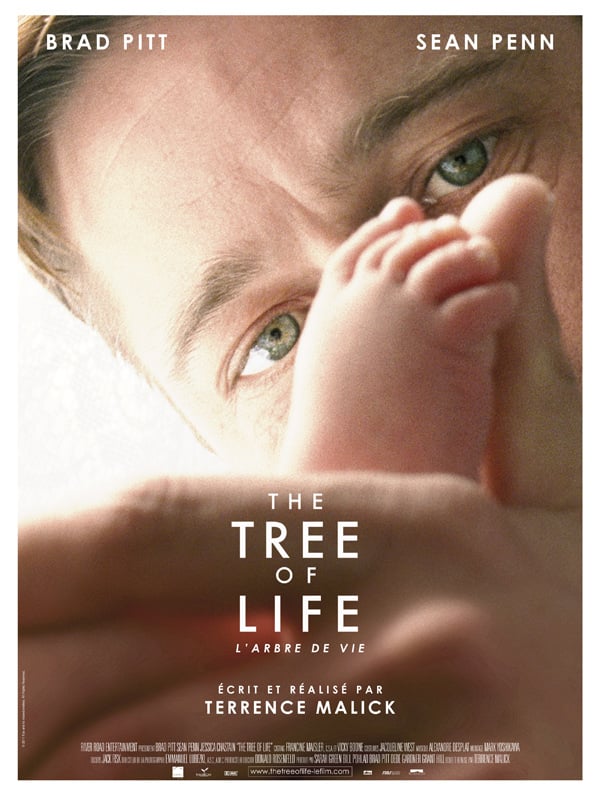Les éloges, les critiques et, encore une fois, l'affiche m'ont fait imaginer une sorte de "Blueberry Nights" version dark, avec autodestruction et impossibilité amoureuse en stock. Mon seul esprit retors est responsable de telles pérégrinations mentales : le film, quant à lui, ne ressemble pas à cela, mais donne tout de même une vorace boule dans la gorge.
"Blue Valentine" réunit Michelle Williams (contre qui j'avais beaucoup d'a-prioris à jamais évaporés) et Ryan Gosling dans une histoire d'amour en deux époques et deux tons. Le thème en lui-même, celui de la décrépitude amoureuse, n'a rien d'original et le procédé narratif utilisé non plus ("Annie Hall" dont je parlais il y a quelques jours l'a fait bien avant lui). C'est alors d'autant plus impressionnant que le film puisse briller à ce point, justement par l'utilisation de maître de cette double temporalité (le bonheur de la rencontre et la mélancolie due au temps passé) et le traitement parfait de ce thème qui a fait tant couler d'encre.
C'est ainsi que l'on suit Dean et Cindy, de leur rencontre au déclin de leur mariage. Les séquences sont habilement montées, permettant de dresser des parallèles qui, à travers le temps, accentuent les émotions, les rendant d'autant plus subtiles et sublimes. Le réalisme dont fait preuve le film est sans précédent, et cela justifie très amplement la lenteur et la tristesse qui empreignent le déclin des sentiments écrasés par le quotidien : si ces deux éléments ont parfois été reprochés au film, ils en font au contraire toute sa qualité.
Ils sont aidés en cela par une réalisation à la fois intime et efficace, et par le jeu étincelant des deux têtes d'affiche, vibrants de sincérité, que ce soit Michelle Williams, fragile et déterminée à la fois, ou Ryan Gosling, entier et émouvant. Les deux virtuoses donnent vie à ce couple dans toutes ses dimensions et nous emmènent dans ses moments les plus beaux comme les plus durs, sans exhibitionnisme mais sans retenue, et toujours avec cette impression de vérité frappante et viscérale.
La beauté cruelle du film se poursuit jusque dans son poignant générique de fin, dernier étalage de souvenirs méchamment jaunis par le temps. La dissection presque scientifique prenant lieu tout le long du film trouve là une froide conclusion, et l'état dans lequel on se retrouve malgré soi à la sortie ne dépend que de ce que l'on veut bien en retenir et en déduire.
mardi 28 juin 2011
lundi 27 juin 2011
"Beginners", Mike Mills
 Mélanie Laurent + Une affiche de vieille comédie romantique à l'américaine telle qu'on devrait les censurer + Mélanie Laurent la nouvelle petite Française exportée outre-Atlantique comme du vin bon marché + Mélanie Laurent = Pas un film que j'avais envie de voir a priori.
Mélanie Laurent + Une affiche de vieille comédie romantique à l'américaine telle qu'on devrait les censurer + Mélanie Laurent la nouvelle petite Française exportée outre-Atlantique comme du vin bon marché + Mélanie Laurent = Pas un film que j'avais envie de voir a priori. "Beginners" semble être une petite comédie romantique à l'eau-de-rose. A la lecture du synopsis, on pouvait prévoir moult situations pseudo-cocasses sans aucune surprise ni retournement scénaristique, entre un Ewan McGregor retombé un peu bas en vieux-beau-éternel-célibataire-cliché, son père à l'écran qui multiplierait les clichés sur les homos et Mélanie Laurent en éternelle dinde qui lui lancerait quelques pics se voulant bien sentis le long du film en attendant de mouiller sa culotte quand il lui fera un inévitable bisou à la fin, scellant la redécouverte de l'amour tant espéré. De quoi faire pleurer les minettes et ronfler les PIFBP. Eh bien, fort heureusement, "Beginners" n'est pas ce qu'il semble être. Dans ce monde d'images, c'est vrai qu'on ferait peut-être bien d'arrêter de juger par l'affiche.
Mike Mills propose ici un film intéressant, assez intelligent et surprenant. Le premier trait qui marque, c'est son scénario. S'il part sur le même principe que beaucoup des films que j'ai vus récemment ("Annie Hall", "Blue Valentine", "The Tree Of Life"...), il parvient à utiliser ce concept à son avantage, aboutissant à un résultat étonnamment bien construit. L'histoire mêle effectivement plusieurs temporalités (deux principales), avec l'audace de se passer de transition nette et la grâce de garder le tout compréhensible à chaque instant malgré cela. Au-delà de ça, elle se paie même le luxe de faire se correspondre des détails dans les époques à travers tout le film, laissant le spectateur comprendre soudain des éléments dont on ne pensait pas, à première vue, qu'il y avait matière à creuser davantage ; exercice de style aussi agréable que réussi. Poussant l'idée jusqu'à ses confins, le film s'interroge, à travers son personnage principal, sur le temps, les époques, la différence entre les vies de maintenant et d'alors, résonnant de façon très juste avec les questions que l'on s'est déjà tous posées, et traitant le sujet avec élégance, bien que parfois un peu en excès. Scénario : première surprise.
Deuxième surprise, l'interprétation. S'il n'était guère surprenant qu'Ewan McGregor s'en tirerait avec talent, j'avais mille fois plus de réserves au sujet de Mélanie Laurent, dont j'ai été un admirateur des premières heures avec le culte "Je vais bien, ne t'en fais pas", mais qui m'a perdu à peu près en même temps que sa couleur capillaire naturelle. J'ai alors grossi malgré moi les rangs du groupe super hype des Mélanie-haters. C'est donc un miracle qu'elle ne m'ait pas vraiment agacé une seule fois dans ce film, où elle joue assez bien, sans doute mieux dirigée et plus à l'aise que dans certains de ses rôles récents ("Inglorious Basterds" vient à l'esprit...). Je n'irai pas jusqu'à acheter son album, mon quota d'actrices qui n'ont pas de voix mais qui chantent et que j'adule étant déjà totalement rempli par Charlotte Gainsbourg, mais je suis réconcilié avec elle.
Enfin, les thèmes. Qu'on se le dise, ce film n'est pas une comédie, bien qu'il recoure à certains procédés comiques (notamment les personnages des meilleurs amis spécial comic-relief) et qu'on sourie donc parfois, à cause des situations effectivement cocasses ou des idées ironiques. Mais ce film est plutôt un drame ; une sorte de drame romantique. Y sont traitées avec précision et force la mort (bien plus tôt que ce qu'on aurait pu croire, par ailleurs), les difficultés amoureuses, la maladie. Par ailleurs, la sexualité du père est traitée de manière sobre et objective, sans le moindre cliché, et enchaîne quelques réalités percutantes, notamment dans le personnage de son petit-ami, dont l'éternel sentiment de victimisation homophobe rappelle avec intelligence à la mesure tout en dénonçant l'intolérance qui l'a sûrement amené à penser ainsi. Le tout selon un schéma narratif surprenant et ne répondant en rien aux codes de la comédie romantique.
Malgré tout cela, cette narration comporte quand même des défauts. Le plus grand en est l'absence d'enjeu dramatique pendant plus des trois quarts du film. Uniquement explicative, voire descriptive, l'histoire, malgré une succession de beaux moments, sonne parfois un peu creux tant on ne voit pas où est le problème ni donc où cela mène. Cela donne lieu à quelques moments de flottement et autres longueurs, d'autant plus que certains thèmes sont étirés au maximum, souvent avec peu de nuance entre les scènes.
Si malgré toutes ces bonnes surprises, le film n'en devient pas pour autant excellent, il sait rester juste, sincère et touchant, et, ma foi, quand on a une affiche comme celle-là, c'est largement suffisant.
dimanche 26 juin 2011
"X-Men : First Class", Matthew Vaughn
J'ai toujours été fan des X-Men. Leur histoire, leurs pouvoirs, les personnages m'ont toujours parlé, et le fait qu'ils aient traversé les années sans prendre de rides dans leur popularité m'a toujours semblé révélateur. C'est ainsi que pendant mon adolescence, la trilogie de films m'a plu, et ce sûrement davantage parce qu'elle traitait des X-Men que pour une réelle qualité cinématographique, comme je m'en rends compte aujourd'hui. Pour ce nouvel opus, le concept de revenir dans le passé me plaisait et était nourri par toutes les critiques positives que j'en entendais. Je voulais vraiment apprécier le film, retrouver cet émerveillement de mes quatorze ans, et me laisser porter par l'histoire et son habituelle balance entre le rêve de la science-fiction et sa portée réaliste. Malheureusement, mon côté PIFBP a dû encore frapper.
X-Men part avec un grave problème : il s'agit de transposer des personnages et des situations éminemment "cools" à l'époque de leur publication, dans un film d'aujourd'hui mais qui traite de cette dite époque. De quoi s'emmêler les pinceaux, et malheureusement, le film se prend souvent les pieds dans un kitsch mal amené et non assumé. Cela se retranscrit aussi bien dans des éléments imputables à la mythologie X-Men (pseudonymes, costumes...) que dans des choix de mise en scène absolument répugnants et une réalisation se voulant beaucoup, mais alors beaucoup trop grandiloquente. Les plans sont rarement soignés, avec des images qui se déforment par une caméra non maîtrisée, et frisent souvent le ridicule, n'assumant jamais un second degré qui aurait été salvateur. A trop vouloir faire dans le spectaculaire, le film en devient la plupart du temps grossier et primaire.
Le scénario, malgré un certain nombre de qualités, pêche aussi par sa simplicité. Le but était donc d'expliquer comment les X-Men ont été constitués, comment Charles Xavier et Erik Lehnsehrr, d'amis, sont devenus les ennemis jurés que l'on connaît, comment le monde a entendu parler pour la première fois des mutants. Malheureusement, le film, en bon blockbuster, se consacre trop aux combats, aux effets spéciaux et compagnie pour traiter le sujet suffisamment en profondeur. Quand ces questions sont résolues, elles le sont sans la moindre surprise, nous laissant nous demander "Euh... C'est tout ?". Tout ça pour ça ; le potentiel pour un scénario d'une réelle complexité était pourtant là. Ici, la division entre Professeur X et Magneto se fait sans panache.
Les X-Men ne sont pourtant jamais aussi beaux, jamais aussi intéressants que quand on s'approche de leur psychologie, tant ils sont tous brisés par l'intolérance de leurs pairs. Si, par moments, le film s'y attache, il ne creuse jamais vraiment le sujet, divisant ses personnages en deux catégories sans davantage y réfléchir. Alors, ceux-ci n'ont plus que leurs cools petits pouvoirs pour faire parler d'eux. La multiplicité des personnages dans un film où le développement de leur psychologie n'est pas la priorité prend alors la forme d'une galerie de personnages qui ne sont que des prétextes à effets spéciaux. De plus, le casting est loin d'être parfait. James McAvoy, malgré une direction moyenne, s'en sort avec les honneurs, et Michael Fassbender est aussi très bon. Dans les rôles secondaires, c'est Nicholas Hoult qui marque le plus par son emprise totale sur son personnage. On regrettera par contre certains choix de belles gueules qui ne savent néanmoins pas jouer, avec surtout January Jones parfaitement mauvaise, et d'autres tous plus oubliables les uns que les autres.
Néanmoins, on appréciera les nombreux clins d'oeil et références au futur ou aux autres films. En faisant une recherche sur le film, j'ai appris que le grand Joss Whedon, dont je suis un fanatique avéré pour son travail notamment sur Buffy the Vampire Slayer (meilleure série au monde, j'y reviendrai), Angel ou Firefly, avait aidé au scénario. C'est sans surprise son travail qui est responsable du point qui m'a particulièrement plu (cf. PIFBP) : l'éternel parallèle entre les mutants et les homosexuels. C'est un sujet qui a toujours été présent dans la série de films "X-Men", comme le disait par exemple Ian McKellen (Magneto dans la trilogie) à l'époque, comme Whedon lui-même l'explique et comme beaucoup d'articles le soulignent sur le net.
Ici, quand la mutation de Hank est révélée et que celui-ci explique à son patron "I was never asked, so I never told.", la référence à la loi "Don't Ask, Don't Tell" qui recommande aux soldats américains homosexuels de ne pas révéler leur orientation, et aux autres de ne pas le demander à leurs camarades, est on ne peut plus claire. Le film tourne donc ainsi autour du sujet de l'intolérance, par quelques passages, et ce genre de moments prouve sa capacité à la subtilité, rendant d'autant plus cruelle son absence le reste du temps. Le film souffre de son côté grand public, et perd trop de temps en combat et en explication bêbête de ce qui est en train de se passer, au lieu de se consacrer à cette fascinante et retentissante psychologie des personnages.
Le film possède au moins le mérite de ne pas trop tomber dans le piège du cliché Américains VS. Méchants Communistes, en se rattrapant par sa fin qui fait voir les choses d'un angle nouveau. Il parvient également à créer de vrais moments de tension et de suspense, malgré un ensemble bien trop kitsch et maladroitement grandiloquent, et permet de se raccrocher à certains moments qui laissent entrevoir le potentiel des personnages dans leur psychologie mais laissent le spectateur sur sa faim.
X-Men part avec un grave problème : il s'agit de transposer des personnages et des situations éminemment "cools" à l'époque de leur publication, dans un film d'aujourd'hui mais qui traite de cette dite époque. De quoi s'emmêler les pinceaux, et malheureusement, le film se prend souvent les pieds dans un kitsch mal amené et non assumé. Cela se retranscrit aussi bien dans des éléments imputables à la mythologie X-Men (pseudonymes, costumes...) que dans des choix de mise en scène absolument répugnants et une réalisation se voulant beaucoup, mais alors beaucoup trop grandiloquente. Les plans sont rarement soignés, avec des images qui se déforment par une caméra non maîtrisée, et frisent souvent le ridicule, n'assumant jamais un second degré qui aurait été salvateur. A trop vouloir faire dans le spectaculaire, le film en devient la plupart du temps grossier et primaire.
Le scénario, malgré un certain nombre de qualités, pêche aussi par sa simplicité. Le but était donc d'expliquer comment les X-Men ont été constitués, comment Charles Xavier et Erik Lehnsehrr, d'amis, sont devenus les ennemis jurés que l'on connaît, comment le monde a entendu parler pour la première fois des mutants. Malheureusement, le film, en bon blockbuster, se consacre trop aux combats, aux effets spéciaux et compagnie pour traiter le sujet suffisamment en profondeur. Quand ces questions sont résolues, elles le sont sans la moindre surprise, nous laissant nous demander "Euh... C'est tout ?". Tout ça pour ça ; le potentiel pour un scénario d'une réelle complexité était pourtant là. Ici, la division entre Professeur X et Magneto se fait sans panache.
Les X-Men ne sont pourtant jamais aussi beaux, jamais aussi intéressants que quand on s'approche de leur psychologie, tant ils sont tous brisés par l'intolérance de leurs pairs. Si, par moments, le film s'y attache, il ne creuse jamais vraiment le sujet, divisant ses personnages en deux catégories sans davantage y réfléchir. Alors, ceux-ci n'ont plus que leurs cools petits pouvoirs pour faire parler d'eux. La multiplicité des personnages dans un film où le développement de leur psychologie n'est pas la priorité prend alors la forme d'une galerie de personnages qui ne sont que des prétextes à effets spéciaux. De plus, le casting est loin d'être parfait. James McAvoy, malgré une direction moyenne, s'en sort avec les honneurs, et Michael Fassbender est aussi très bon. Dans les rôles secondaires, c'est Nicholas Hoult qui marque le plus par son emprise totale sur son personnage. On regrettera par contre certains choix de belles gueules qui ne savent néanmoins pas jouer, avec surtout January Jones parfaitement mauvaise, et d'autres tous plus oubliables les uns que les autres.
Néanmoins, on appréciera les nombreux clins d'oeil et références au futur ou aux autres films. En faisant une recherche sur le film, j'ai appris que le grand Joss Whedon, dont je suis un fanatique avéré pour son travail notamment sur Buffy the Vampire Slayer (meilleure série au monde, j'y reviendrai), Angel ou Firefly, avait aidé au scénario. C'est sans surprise son travail qui est responsable du point qui m'a particulièrement plu (cf. PIFBP) : l'éternel parallèle entre les mutants et les homosexuels. C'est un sujet qui a toujours été présent dans la série de films "X-Men", comme le disait par exemple Ian McKellen (Magneto dans la trilogie) à l'époque, comme Whedon lui-même l'explique et comme beaucoup d'articles le soulignent sur le net.
Ici, quand la mutation de Hank est révélée et que celui-ci explique à son patron "I was never asked, so I never told.", la référence à la loi "Don't Ask, Don't Tell" qui recommande aux soldats américains homosexuels de ne pas révéler leur orientation, et aux autres de ne pas le demander à leurs camarades, est on ne peut plus claire. Le film tourne donc ainsi autour du sujet de l'intolérance, par quelques passages, et ce genre de moments prouve sa capacité à la subtilité, rendant d'autant plus cruelle son absence le reste du temps. Le film souffre de son côté grand public, et perd trop de temps en combat et en explication bêbête de ce qui est en train de se passer, au lieu de se consacrer à cette fascinante et retentissante psychologie des personnages.
Le film possède au moins le mérite de ne pas trop tomber dans le piège du cliché Américains VS. Méchants Communistes, en se rattrapant par sa fin qui fait voir les choses d'un angle nouveau. Il parvient également à créer de vrais moments de tension et de suspense, malgré un ensemble bien trop kitsch et maladroitement grandiloquent, et permet de se raccrocher à certains moments qui laissent entrevoir le potentiel des personnages dans leur psychologie mais laissent le spectateur sur sa faim.
"Annie Hall", Woody Allen
Déjà la deuxième critique sur un Woody Allen... C'est du propre... Souhaitant combler mes énormes lacunes sur le cinéma pré-90s, je me suis lancé dans le visionnage de "Annie Hall", dont on m'a dit beaucoup de bien récemment.
Je parlais il y a quelque temps de "(500) Days of Summer", "Medianeras"... et même "Blue Valentine"... En voyant "Annie Hall", j'ai non seulement compris pourquoi ce film avait été tant récompensé et comment Woody Allen s'était forgé sa réputation, mais j'ai aussi et surtout vu à quel point tous ces films sus-cités sont en fait dans la veine de films comme "Annie Hall". Comme je l'ai dit, mon manque de culture cinématographique probante m'empêche de dresser les parallèles sans tirer des plans sur la comète, mais, à ce que j'en imagine, ce film devait être incroyablement novateur pour l'époque.
J'en retiens, au-delà de la période du film très agréable à contempler, l'intelligence de la narration, qui manie les flash-backs et les temporalités avec une aisance remarquable et une fluidité de maître, tout en gardant une certaine patte Allen déjà reconnaissable, notamment dans les scènes du passé mises en scène devant les personnages du présent. De nombreux procédés cinématographiques originaux sont ici utilisés et font le charme désuet du film.
L'histoire d'amour, au sens général du terme, est racontée dans un ordre qui lui correspond davantage que la chronologie et qui est tellement juste qu'il glisse tout seul sans jamais faire froncer les sourcils au spectateur. Toute la force du film réside sûrement en l'universalité des sentiments qui est décrite ici. En effet, malgré les caractères bien marqués et loufoques des protagonistes, leur histoire touche et peut toucher tout le monde puisque ce qu'elle raconte est commun et permet, ne serait-ce que par moments, de s'identifier aux situations sans s'y attendre. La décrépitude du couple est décrite avec intelligence et rigueur, et apparaît comme un revers à l'intimité qui s'installe ; laissant le terrain libre aux personnages pour trouver ou non leur juste milieu.
J'avoue émettre une retenue quant au personnage de Alvy Singer, et sa réversibilité déroutante avec Woody Allen lui-même. Cela donne parfois une impression étrange de voyeurisme. La limite n'est pas claire : est-ce inspiré de faits réels, ou caricaturé, ou alors une facilité d'écriture, ou encore un hasard, si Woody et Alvy sonnent comme la même personne ? Bien que ce ne soit pas grave en soi, cela remet légèrement en cause le jeu d'acteur d'Allen, et surtout, cela laisse sur sa faim, à se demander si Allen écrit ce film uniquement pour lui ou pour les autres. Cela résonne avec le titre du film : alors que le film s'articule totalement autour d'Alvy et raconte son histoire, le titre ne mentionne qu'Annie, comme si Allen lui-même racontait ce passage de sa vie.
Dans tous les cas, le scénario étonne, amuse et captive. Malgré un certain recul dû à quelques longueurs, il est difficile de ne pas se demander, un peu tendu, à la fin, ce qui va leur arriver. Quand la conclusion est apportée, ne reste que la subjectivité laissée au spectateur pour son choix : faut-il se tourner vers le pessimisme ou vers l'espoir ? On ne peut pas s'empêcher de penser que le choix d'Allen et de son personnage n'est peut-être pas celui qu'il prétend.
Je parlais il y a quelque temps de "(500) Days of Summer", "Medianeras"... et même "Blue Valentine"... En voyant "Annie Hall", j'ai non seulement compris pourquoi ce film avait été tant récompensé et comment Woody Allen s'était forgé sa réputation, mais j'ai aussi et surtout vu à quel point tous ces films sus-cités sont en fait dans la veine de films comme "Annie Hall". Comme je l'ai dit, mon manque de culture cinématographique probante m'empêche de dresser les parallèles sans tirer des plans sur la comète, mais, à ce que j'en imagine, ce film devait être incroyablement novateur pour l'époque.
J'en retiens, au-delà de la période du film très agréable à contempler, l'intelligence de la narration, qui manie les flash-backs et les temporalités avec une aisance remarquable et une fluidité de maître, tout en gardant une certaine patte Allen déjà reconnaissable, notamment dans les scènes du passé mises en scène devant les personnages du présent. De nombreux procédés cinématographiques originaux sont ici utilisés et font le charme désuet du film.
L'histoire d'amour, au sens général du terme, est racontée dans un ordre qui lui correspond davantage que la chronologie et qui est tellement juste qu'il glisse tout seul sans jamais faire froncer les sourcils au spectateur. Toute la force du film réside sûrement en l'universalité des sentiments qui est décrite ici. En effet, malgré les caractères bien marqués et loufoques des protagonistes, leur histoire touche et peut toucher tout le monde puisque ce qu'elle raconte est commun et permet, ne serait-ce que par moments, de s'identifier aux situations sans s'y attendre. La décrépitude du couple est décrite avec intelligence et rigueur, et apparaît comme un revers à l'intimité qui s'installe ; laissant le terrain libre aux personnages pour trouver ou non leur juste milieu.
J'avoue émettre une retenue quant au personnage de Alvy Singer, et sa réversibilité déroutante avec Woody Allen lui-même. Cela donne parfois une impression étrange de voyeurisme. La limite n'est pas claire : est-ce inspiré de faits réels, ou caricaturé, ou alors une facilité d'écriture, ou encore un hasard, si Woody et Alvy sonnent comme la même personne ? Bien que ce ne soit pas grave en soi, cela remet légèrement en cause le jeu d'acteur d'Allen, et surtout, cela laisse sur sa faim, à se demander si Allen écrit ce film uniquement pour lui ou pour les autres. Cela résonne avec le titre du film : alors que le film s'articule totalement autour d'Alvy et raconte son histoire, le titre ne mentionne qu'Annie, comme si Allen lui-même racontait ce passage de sa vie.
Dans tous les cas, le scénario étonne, amuse et captive. Malgré un certain recul dû à quelques longueurs, il est difficile de ne pas se demander, un peu tendu, à la fin, ce qui va leur arriver. Quand la conclusion est apportée, ne reste que la subjectivité laissée au spectateur pour son choix : faut-il se tourner vers le pessimisme ou vers l'espoir ? On ne peut pas s'empêcher de penser que le choix d'Allen et de son personnage n'est peut-être pas celui qu'il prétend.
"The Tree Of Life", Terrence Malick
Je n'étais pas très motivé à l'idée d'aller voir ce film dont j'avais entendu beaucoup de mal, mais il m'était important de me faire mon propre avis sur la fameuse et polémique "Palme d'Or". Je ne savais pas si le snobinardisme cinématographique de pseudo-intellectuel-futur-bobo-pédé (PIFBP, donc) que je suis en train de développer suffirait à me faire apprécier le film. Malheureusement, il semblerait bien que oui ; misère.
Ce qu'on oublie souvent de préciser quant à ce film, c'est que "The Tree Of Life" commence dans la mort pour s'interroger sur la vie dans tous les sens du terme, par tout un déroulé d'images et de souvenirs qui arrivent naturellement en réponse au deuil. Ces séquences atteignent un puissant niveau de symbolisme laissant une place appréciable à l'interprétation personnelle. Et si la mienne est relativement simple, elle m'a permis d'aimer le film. La principale critique portant sur le film porte souvent sur cette longue succession d'images de nature, de "catastrophes naturelles", de paysages, puis des fameux dinosaures. Pourtant, une logique peut y être décelée : le personnage de la mère voit la confrontation entre sa foi et son incompréhension du décès, et toutes les questions qui en découlent pour une personne croyante sont traitées à travers les quelques lignes de dialogues saupoudrées sur ces images magnifiques. On y retrouve la violence de la douleur, la remise en cause de la foi, et toutes les questions métaphysiques que l'on se pose dans de telles circonstances. Le tout étant porté par la pure beauté des images et de leur succession. Une grâce semble s'en dégager, et le choix de la confrontation des dinosaures m'a ému plutôt que dérangé.
Une deuxième partie du film se consacre plutôt au personnage du fils qui se remémore ses souvenirs d'enfance. Malheureusement, à s'attarder trop sur les plans, le film omet d'installer correctement les bases pour que l'on puisse comprendre directement les retours dans le passé, et notamment quel enfant est quel adulte... Cependant, les scènes s'enchaînent avec une douceur et un réalisme de l'enfance qui est parfois frappant, notamment dans les passages sur l'apprentissage de la tolérance, de la différence, le tout en quelques plans souvent sans dialogue et pourtant d'une clarté limpide. De nombreux thèmes sont traités, me rappelant Enfance de Nathalie Sarraute que je lis actuellement. Une réflexion sur l'éducation en découle, forte et troublante, portée par le personnage de Brad Pitt très finement dessiné et par ses prenants rapports avec sa famille, tantôt touchants souvent terribles. En parallèle, l'horreur du décès pour la famille apparaît de plus en plus claire et violente, et c'est sûrement là tout le mérite du film : il parvient, par les mêmes images, à traiter l'enfance, le deuil, la mort, la vie. Un travail hors-du-commun.
Le film est un exemple parfait de la capacité qu'un cinéaste peut avoir à magnifier totalement son scénario par une réalisation toujours incroyablement adaptée, et une interprétation absolument impeccable. Brad Pitt surprend par sa subtile justesse, et vole la vedette à Sean Penn qui souffre de son peu de temps d'écran. Les enfants sont tout aussi impressionnants et leur jeu témoigne d'une direction de qualité. Mais la mention d'honneur revient à l'indescriptible Jessica Chastain, absolument parfaite et magnifique.
Évidemment, les critiques qui ont été faites au film sont aussi compréhensible. "The Tree Of Life" souffre de sa position particulière. Il possède le casting et l'exposition médiatique d'un blockbuster tout en présentant le fond d'un film d'art et d'essai. Dans de telles conditions, ce n'est pas étonnant que mes jeunes voisines aient ricané pendant la longue séquence de début : "Il est où, Brad Pitt, putain ?". Il est vrai, de plus, que malgré cette grandiose réalisation, ces plans magnifiques, ce jeu impeccable, ce thème fort, le film pêche tout de même par certaines séquences dont le symbolisme apparaît un peu trop opaque, rendant quelque peu aléatoire l'appréciation du film par le spectateur selon l'état émotionnel dans lequel il se trouve lors du visionnage du film.
Par ailleurs, et en dépit de tout, les longueurs sont bien présentes : quelque chose de plus concis aurait peut-être été préférable, mais à vrai dire, surtout au niveau de la deuxième partie, tant la première était frappante par les enchaînements de ses images majestueuses. Malheureusement, cette longueur excessive fait qu'en dépit de tout, ce n'est pas un film que j'aurais spécialement envie de revoir. Je suis néanmoins très heureux de l'avoir vu, tant je n'avais pas témoigné d'un tel travail sur l'image et la portée symbolique depuis "Antéchrist", sur lequel "The Tree Of Life" possède l'avantage de la qualité du thème, intimement beau. Il mérite à mes yeux sa Palme d'Or et, bien qu'un peu trop élitiste, restera un travail cinématographique juste et unique.
Ce qu'on oublie souvent de préciser quant à ce film, c'est que "The Tree Of Life" commence dans la mort pour s'interroger sur la vie dans tous les sens du terme, par tout un déroulé d'images et de souvenirs qui arrivent naturellement en réponse au deuil. Ces séquences atteignent un puissant niveau de symbolisme laissant une place appréciable à l'interprétation personnelle. Et si la mienne est relativement simple, elle m'a permis d'aimer le film. La principale critique portant sur le film porte souvent sur cette longue succession d'images de nature, de "catastrophes naturelles", de paysages, puis des fameux dinosaures. Pourtant, une logique peut y être décelée : le personnage de la mère voit la confrontation entre sa foi et son incompréhension du décès, et toutes les questions qui en découlent pour une personne croyante sont traitées à travers les quelques lignes de dialogues saupoudrées sur ces images magnifiques. On y retrouve la violence de la douleur, la remise en cause de la foi, et toutes les questions métaphysiques que l'on se pose dans de telles circonstances. Le tout étant porté par la pure beauté des images et de leur succession. Une grâce semble s'en dégager, et le choix de la confrontation des dinosaures m'a ému plutôt que dérangé.
Une deuxième partie du film se consacre plutôt au personnage du fils qui se remémore ses souvenirs d'enfance. Malheureusement, à s'attarder trop sur les plans, le film omet d'installer correctement les bases pour que l'on puisse comprendre directement les retours dans le passé, et notamment quel enfant est quel adulte... Cependant, les scènes s'enchaînent avec une douceur et un réalisme de l'enfance qui est parfois frappant, notamment dans les passages sur l'apprentissage de la tolérance, de la différence, le tout en quelques plans souvent sans dialogue et pourtant d'une clarté limpide. De nombreux thèmes sont traités, me rappelant Enfance de Nathalie Sarraute que je lis actuellement. Une réflexion sur l'éducation en découle, forte et troublante, portée par le personnage de Brad Pitt très finement dessiné et par ses prenants rapports avec sa famille, tantôt touchants souvent terribles. En parallèle, l'horreur du décès pour la famille apparaît de plus en plus claire et violente, et c'est sûrement là tout le mérite du film : il parvient, par les mêmes images, à traiter l'enfance, le deuil, la mort, la vie. Un travail hors-du-commun.
Le film est un exemple parfait de la capacité qu'un cinéaste peut avoir à magnifier totalement son scénario par une réalisation toujours incroyablement adaptée, et une interprétation absolument impeccable. Brad Pitt surprend par sa subtile justesse, et vole la vedette à Sean Penn qui souffre de son peu de temps d'écran. Les enfants sont tout aussi impressionnants et leur jeu témoigne d'une direction de qualité. Mais la mention d'honneur revient à l'indescriptible Jessica Chastain, absolument parfaite et magnifique.
Évidemment, les critiques qui ont été faites au film sont aussi compréhensible. "The Tree Of Life" souffre de sa position particulière. Il possède le casting et l'exposition médiatique d'un blockbuster tout en présentant le fond d'un film d'art et d'essai. Dans de telles conditions, ce n'est pas étonnant que mes jeunes voisines aient ricané pendant la longue séquence de début : "Il est où, Brad Pitt, putain ?". Il est vrai, de plus, que malgré cette grandiose réalisation, ces plans magnifiques, ce jeu impeccable, ce thème fort, le film pêche tout de même par certaines séquences dont le symbolisme apparaît un peu trop opaque, rendant quelque peu aléatoire l'appréciation du film par le spectateur selon l'état émotionnel dans lequel il se trouve lors du visionnage du film.
Par ailleurs, et en dépit de tout, les longueurs sont bien présentes : quelque chose de plus concis aurait peut-être été préférable, mais à vrai dire, surtout au niveau de la deuxième partie, tant la première était frappante par les enchaînements de ses images majestueuses. Malheureusement, cette longueur excessive fait qu'en dépit de tout, ce n'est pas un film que j'aurais spécialement envie de revoir. Je suis néanmoins très heureux de l'avoir vu, tant je n'avais pas témoigné d'un tel travail sur l'image et la portée symbolique depuis "Antéchrist", sur lequel "The Tree Of Life" possède l'avantage de la qualité du thème, intimement beau. Il mérite à mes yeux sa Palme d'Or et, bien qu'un peu trop élitiste, restera un travail cinématographique juste et unique.
mardi 21 juin 2011
"Medianeras", Gustavo Taretto
Pour voir un film, mieux vaut ne rien en savoir au préalable. C'est quand les attentes sont nulles, ou encore basses, que les surprises se font les meilleures. J'y reviendrai mais pour "Medianeras", j'aurais préféré ne même pas avoir vu la bande-annonce, qui m'a gâché la scène de fin. Mais c'est sans connaître la signification de son titre, que j'ai bredouillé maladroitement au caissier maussade, que je suis allé voir ce film hispano-germano-argentin. J'ai donc pu involontairement sauvegarder ce sentiment particulier du moment où l'on comprend pourquoi le film a été ainsi nommé, avec cette impression de satisfaction sublimant le tout, de dernière pièce du puzzle posée. J'ai ressenti cela pour la première fois dans "Les Poupées Russes", et pour "Medianeras", l'émotion était d'autant plus présente.
Le concept est simple : c'est le portrait croisé de deux personnes, qui habitent tout près, ne se connaissent pas mais se cherchent. Une des forces narratives du film tient en ces multiples rencontres en décalé, qui résonnent avec la réflexion que l'on s'est tous fait, selon laquelle il existe sûrement des inconnus que l'on croise plusieurs fois par jour, qui partagent nos habitudes de quartier et de vie et qui, pourtant, nous passent inaperçus. Ainsi, ces moments à l'envolée où les deux personnages se croisent ou interagissent en décalé dans le temps ou l'espace, forment à chaque fois comme un malicieux et intelligent clin d'oeil, dont on a un peu plus envie à chaque fois que ce soit celle de la rencontre, établissant un genre de suspense intéressant.
Bien sûr, et surtout quand on n'aime pas forcément les films d'amour comme c'est mon cas, on pourra regretter le fait que Martìn et Mariana semblent parfois se correspondre un peu trop parfaitement. Cela n'apparaît a priori pas suffisamment réaliste pour porter le message du film, à savoir que chacun peut trouver la perle rare à condition de chercher, parce qu'elle cherche aussi. Cependant, ce côté légèrement exagéré est rattrapé par tout le reste du film : la caractérisation indépendante de chaque personnage, leurs pérégrinations amoureuses et anxieuses, leurs erreurs, leurs doutes, et surtout leur rencontre qui peut alors s'effectuer tout en retenue, puisqu'il a déjà été amplement démontré à quel point ils seraient et seront bien ensemble. C'est ainsi que malgré tout, le message d'espoir et d'amour perce.
Étrangement, c'est en alternant des séquences relativement longues de l'un puis de l'autre que le film, malgré quelques longueurs en conséquence, parvient à rendre les deux personnages tout aussi attachants. Le jeu impeccable porté par un très bon choix de casting concourt à cette réussite. Martìn (Javier Drolas, ténébreux et lumineux à la fois) est plus facilement caractérisable, dès le début, par ses nombreux problèmes de santé mentale, mais le film a l'intelligence de se détacher rapidement de cela pour explorer sa personnalité en profondeur, loin de toute considération psychiatrique. Mariana (Pilar López de Ayala, fragile et imposante), de son côté, connaît une description d'emblée plus subtile, plus mystérieuse aussi parfois, comme si, contrairement à lui, elle ne pouvait pas se réfugier derrière quelques étiquettes symptomatiques. C'est ce qui les rend différents et les unit intimement, à la fois, tout en les rendant bouleversants et humains.
Ce petit bijou par Gustavo Taretto n'est pas sans rappeler l'excellent "(500) Days of Summer", dont il évoque parfois une sorte de version par cette Amérique qui est plus au Sud que l'autre. Mais si les deux semblent s'inscrire dans un mouvement semblable, si on y retrouve une "story of boy meets girl", des réflexions subsidiaires similaires, notamment sur l'amour ou l'architecture, et surtout la modernité des procédés cinématographiques utilisés, la comparaison s'arrête vite, tant "Medianeras" est bien un film à part entière et indépendant de tout le reste, caractérisé qui plus est ce grain de photographie latin qui donne un air suranné, à la fois morose et grisé dans tous les sens du terme.
Malgré quelques ratés, la réalisation s'avère soignée et originale, dynamique et moderne, contrastant agréablement avec l'apparente tristesse que ressentent souvent les protagonistes. On note notamment un vrai jeu sur la luminosité, justifié par la fin. La réalisation permet aux quelques réflexions sur la société moderne d'illustrer avec fluidité et intelligence tout le récit. Le sens qu'elles portent est bien venu, bien dosé et bien pensé, et permet de caractériser d'autant plus les personnages, par l'anxiété qui explique qu'ils méditent sur de tels sujets.
Elles sont aidées en cela par de multiples petites trouvailles narratives, ces détails scénaristiques qui enrichissent le film en lui-même. C'est à mes yeux ce qui fait toute la force percutante de l'art : au-delà de l'histoire ou du thème, il s'agit de tout ce qui s'articule autour. Des idées, des répliques, des morceaux de décor, des manies ou des goûts des personnages, des envies de mise en scène, des éléments de réalisation innovante, légère et intelligente. Ici, ce sont toutes ces petites pierres qui forment un double édifice artistique, définissant l'identité du film en même temps que celle de ses personnages. C'est bien par là que "Medianeras" brille : chaque plan et chaque seconde tendent comme autant de coups de pinceaux vers le perfectionnement de deux portraits presque hermétiques qui finissent par n'en devenir plus qu'un.

C'est ainsi qu'on parvient à un film à la fois sobre et fantasque, où les deux portraits sont si bien dressés qu'on les accepte pour tout ce qu'ils ont à offrir, et qu'on en vient à se dire que, quitte à raconter une rencontre, tous les films romantiques devraient ressembler à "Medianeras".
lundi 13 juin 2011
"Midnight in Paris", Woody Allen
(Bon, ok. Y'a rien de pire que les débuts de blog. Je propose qu'on commence, tout simplement.)
Enfin retiré de mon isolation estudiantine, j'ai pu commencer ma grande campagne de ré-rentabilisation de la carte UGC Illimité, financée pour du beurre lors de ces derniers mois. Pour entreprendre cette démarche tant attendue, j'ai profité d'un trou dans mon emploi du temps étonnamment chargé pour une période de libération vacancière en débutant par le nouveau Woody Allen tant acclamé.
Le "nouveau Woody Allen", déjà ; parce que c'est devenu une habitude. Les films de Woody Allen sont comme le Beaujolais Nouveau ou la Fête de la Musique : chaque année, on en entend parler quelques mois auparavant et on se rappelle soudain de leur existence, on se renseigne rapidement et on se dit qu'on ira peut-être, cette fois, enfin, si on en a l'occasion. Et si on le rate, c'est pas très grave, il restera toujours l'an prochain.
"Minuit à Paris", contre toute attente ou en tout cas tout synopsis que j'aie pu lire dans la phase de pré-information sus-citée, renoue avec une certaine inclinaison fantastique. Le charme opère donc d'autant plus si on ne s'y attend pas, comme moi qui étais resté sur les intrigues amoureuses pseudo-modernes de "Whatever Works". Alors, on accompagne Gil dans cette lente compréhension pleine de doutes, saupoudrée d'une légère féérie inexpliquée et suivie d'un enthousiasme rêveur. Sympathiques caractéristiques du genre.
Pourtant, il faut le dire, l'histoire en elle-même ne déborde pas d'originalité. Le scénario saute la tête la première dans chacune de nos attentes. La morale est sauve, les quelques doutes sont comblés, chacun y trouve son compte, et tout s'arrange quand même vachement bien, pour finir : voilà qui tombe remarquablement bien. Le côté fantastique pose sa graine d'originalité agréable mais rappelle bien trop "La Rose Pourpre du Caire" pour vraiment surprendre.
Car on en est là : un film de Woody Allen s'apprécie comme une réunion de famille chez ses grands-parents. Ca fait plaisir, c'est familier, c'est habituel, presque routinier. Et même si les détails varient, les gens changent un peu, on retrouve cet éternel côté désuet, signé notamment par une photographie jaunie et des fondus qui ont bien mal vieilli.
Je n'ai pas la prétention d'avoir vu beaucoup de films de Woody Allen même si c'est une expérience qui me plairait ; dans de telles conditions, il serait aisé de crier au génie. Mais le génie était là bien avant moi. Et si, avec mon maigre ratio de films vus, je suis capable de voir les ficelles qui se répètent et les procédés devenus routiniers, il est tristement facile de conclure que le génie est un peu reparti, depuis.
Je passerai rapidement sur la piètre performance de Marion Cotillard, qui a signé ma décision d'arrêter d'espérer à son sujet, tant ses minauderies incessantes semblent désormais gravées sur son visage comme une rhinoplastie ratée. Je n'ai même pas envie de parler de Carla Bruni, deux des trois scènes de son rôle ayant été clairement écrites pour justifier sa présence et la visqueuse promotion qui allait être faite autour, son "jeu" ne témoignant que du fait qu'elle ne s'était absolument jamais retrouvée dans la position de son personnage : Carla Bruni n'aura joué que Carla Bruni. Fort heureusement, les autres acteurs réussissent à faire sourire ou rêver, sans trop impressionner mais en ayant la bonne idée d'être souvent justes. Mention spéciale à Kathy Bates, choix indiscutable.
En dépit d'une promotion parisienne trop ostentatoire et poisseuse, et de tous les défauts précédemment cités, le charme suranné fait malgré tout parfois effet, le tout embelli par le charme des années vingt et le thème de l'écriture sans cesse torturée par soi ou les autres. Si le film n'apporte rien de bien nouveau à cet éternel débat, il permet un rappel bien vu sur l'importance de l'art par ce voyage à travers les époques. Beaucoup d'idées intéressantes sont lancées : l'interprétation de l'art, la part de subjectivité de l'artiste et du spectateur, analyste ou badaud, l'importance d'être honnête envers soi-même dans son art. Malheureusement, peu sont suffisamment approfondies, mais c'est peut-être mieux quand on voit combien la morale de l'histoire est explicitée devant le spectateur de la même façon qu'on explique et gâche le sens d'une blague. On aurait aimé, pour le coup, que la chose se fasse de manière un peu plus subtile... ou qu'on fasse un peu plus confiance aux fameux interprètes de l'art.
Enfin retiré de mon isolation estudiantine, j'ai pu commencer ma grande campagne de ré-rentabilisation de la carte UGC Illimité, financée pour du beurre lors de ces derniers mois. Pour entreprendre cette démarche tant attendue, j'ai profité d'un trou dans mon emploi du temps étonnamment chargé pour une période de libération vacancière en débutant par le nouveau Woody Allen tant acclamé.
Le "nouveau Woody Allen", déjà ; parce que c'est devenu une habitude. Les films de Woody Allen sont comme le Beaujolais Nouveau ou la Fête de la Musique : chaque année, on en entend parler quelques mois auparavant et on se rappelle soudain de leur existence, on se renseigne rapidement et on se dit qu'on ira peut-être, cette fois, enfin, si on en a l'occasion. Et si on le rate, c'est pas très grave, il restera toujours l'an prochain.
"Minuit à Paris", contre toute attente ou en tout cas tout synopsis que j'aie pu lire dans la phase de pré-information sus-citée, renoue avec une certaine inclinaison fantastique. Le charme opère donc d'autant plus si on ne s'y attend pas, comme moi qui étais resté sur les intrigues amoureuses pseudo-modernes de "Whatever Works". Alors, on accompagne Gil dans cette lente compréhension pleine de doutes, saupoudrée d'une légère féérie inexpliquée et suivie d'un enthousiasme rêveur. Sympathiques caractéristiques du genre.
Pourtant, il faut le dire, l'histoire en elle-même ne déborde pas d'originalité. Le scénario saute la tête la première dans chacune de nos attentes. La morale est sauve, les quelques doutes sont comblés, chacun y trouve son compte, et tout s'arrange quand même vachement bien, pour finir : voilà qui tombe remarquablement bien. Le côté fantastique pose sa graine d'originalité agréable mais rappelle bien trop "La Rose Pourpre du Caire" pour vraiment surprendre.
Car on en est là : un film de Woody Allen s'apprécie comme une réunion de famille chez ses grands-parents. Ca fait plaisir, c'est familier, c'est habituel, presque routinier. Et même si les détails varient, les gens changent un peu, on retrouve cet éternel côté désuet, signé notamment par une photographie jaunie et des fondus qui ont bien mal vieilli.
Je n'ai pas la prétention d'avoir vu beaucoup de films de Woody Allen même si c'est une expérience qui me plairait ; dans de telles conditions, il serait aisé de crier au génie. Mais le génie était là bien avant moi. Et si, avec mon maigre ratio de films vus, je suis capable de voir les ficelles qui se répètent et les procédés devenus routiniers, il est tristement facile de conclure que le génie est un peu reparti, depuis.
Je passerai rapidement sur la piètre performance de Marion Cotillard, qui a signé ma décision d'arrêter d'espérer à son sujet, tant ses minauderies incessantes semblent désormais gravées sur son visage comme une rhinoplastie ratée. Je n'ai même pas envie de parler de Carla Bruni, deux des trois scènes de son rôle ayant été clairement écrites pour justifier sa présence et la visqueuse promotion qui allait être faite autour, son "jeu" ne témoignant que du fait qu'elle ne s'était absolument jamais retrouvée dans la position de son personnage : Carla Bruni n'aura joué que Carla Bruni. Fort heureusement, les autres acteurs réussissent à faire sourire ou rêver, sans trop impressionner mais en ayant la bonne idée d'être souvent justes. Mention spéciale à Kathy Bates, choix indiscutable.
En dépit d'une promotion parisienne trop ostentatoire et poisseuse, et de tous les défauts précédemment cités, le charme suranné fait malgré tout parfois effet, le tout embelli par le charme des années vingt et le thème de l'écriture sans cesse torturée par soi ou les autres. Si le film n'apporte rien de bien nouveau à cet éternel débat, il permet un rappel bien vu sur l'importance de l'art par ce voyage à travers les époques. Beaucoup d'idées intéressantes sont lancées : l'interprétation de l'art, la part de subjectivité de l'artiste et du spectateur, analyste ou badaud, l'importance d'être honnête envers soi-même dans son art. Malheureusement, peu sont suffisamment approfondies, mais c'est peut-être mieux quand on voit combien la morale de l'histoire est explicitée devant le spectateur de la même façon qu'on explique et gâche le sens d'une blague. On aurait aimé, pour le coup, que la chose se fasse de manière un peu plus subtile... ou qu'on fasse un peu plus confiance aux fameux interprètes de l'art.
Inscription à :
Articles (Atom)